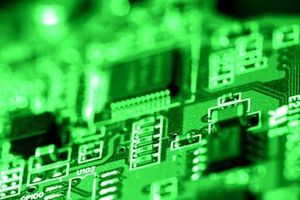Le Véritable Choc Pétrolier
Un Iran doté d’armes nucléaires est la seule vraie menace contre l’économie mondiale
[remarque : cette analyse, émise par deux experts des marché pétroliers est séminale dans le conflit d'interprétation qui s'est ouvert entre Israël et l'Administration Obama, avec l'annulation des grandes manoeuvres Austere Challenge 12, prévues au printemps.]
En 1993, James Carville, le stratège politique de Bill Clinton, disait que “si jamais la réincarnation existe”, il aimerait revenir sous l’apparence du « marché obligataire », parce qu’ainsi il pourrait « faire peur à tout le monde ». Aujourd’hui, avec des taux d’intérêt historiquement bas, ce choix imaginaire se reporterait, sans aucun doute, sur le fantasme de revenir sous la forme du marché du pétrole, qui intimide même les Etats-Unis.

Cargo pétrolier dans le Golfe Persique.
EPA / ABEDIN TAHERKENAREH / LANDOV
La hantise du marché pétrolier et de son impact sur l’économie fragile des Etats-Unis et du monde est apparemment un facteur déterminant de la politique iranienne de l’Administration Obama. L’Administration a cité cette crainte, d’abord en s’opposant, puis en affaiblissant la législation qui devait sanctionner la Banque Centrale Iranienne et en minimisant les perspectives d’une attaque militaire contre les installations militaires iraniennes. Alors que l’Administration a raison de s’en préoccuper, elle devrait aussi adopter une vision à plus long terme. Une analyse plus complète du marché pétrolier suggère que de permettre à l’Iran de développer des capacités d’accès à l’arme nucléaire provoquerait une plus forte hausse du prix du pétrole, pour une durée plus longue que ne le ferait jamais une action prise pour l’en empêcher.
Le 1er décembre, le Sénat s’est porté par 100 votes à 0 en faveur de la législation, promulguée par les Sénateurs Mark Kirk et Robert Menendez, pour sanctionner les sociétés qui font des affaires avec la Banque Centrale d’Iran (BCI). Un objectif fondamental de cette législation était de casser les exportations de pétrole de l’Iran, qui sont financées à travers les mécanismes de la BCI et fournissent plus de la moitié du revenu de l’Etat iranien. C’était une réalisation notable. Nombreux sont ceux qui considèrent les sanctions contre la BCI comme « l'arme fatale, [l’option atomique] » des sanctions et la meilleure possible, et peut-être la dernière disponible, ce qui signifie : en dehors d’une action militaire visant à éviter un Iran nucléaire. L’Administration, cependant, s’est opposée à cette législation, en partie parce que soucieuse du fait que cela réduirait l’offre de pétrole présente sur le marché, poussant à l’augmentation des tarifs et sapant ainsi l’économie globale fragile – ceci à un moment où le Président Obama se focalise sur sa réélection.
L’Administration est parvenue à persuader les auteurs du projet qu’il fallait adoucir cette loi, qui a, finalement, été votée par les deux chambres du Congrès, le 15 décembre. Obama l’a contresignée le 31 décembre. Elle donnait au Président une plus large marge de manœuvre pour décider si et quelle sorte de sanctions imposer aux institutions financières commerçant avec la BCI. Les sanctions devrait prendre effet six mois après la signature du passage de la loi. Le Président peut offrir des dérogations aux institutions financières dont les pays d’origine coopèrent avec la politique des Etats-Unis à l'encontre de l’Iran, et peut renoncer à toutes les sanctions en totalité, si c’est dans « l’intérêt de la sécurité nationale » des Etats-Unis. L’Administration doit informer le Congrès tous les deux mois, s’il y a suffisamment d'approvisionnement en pétrole non-iranien pour permettre aux acheteurs étrangers de brut iranien de réduire significativement leurs achats à l’égard de l’Iran. Il existe un nouveau cycle de règles juridiques sur des sanctions potentiellement plus sévères qui devrait passer au printemps : il inclut de sanctionner la BCI, si on détermine qu’elle soutient le programme d’armes de destruction massive de l’Iran ou le terrorisme.
Pour que ces sanctions exercent une quelconque pression significative sur l’Iran, le soutien international est crucial, puisque, déjà, les compagnies américaines n’achètent pas de pétrole iranien. Au contraire, presque les trois-quarts des exportations de pétrole iranien, durant les 11 premiers mois de 2011 ont été achetés par quatre pays : la Chine (27%), l’Inde (18 %), la Corée du Sud (12%) et le Japon (16%). L’Union Européenne n’a seulement acheté qu’un peu plus plus que l’Inde (22 %), avec l’Italie, qui est le plus gros acheteur (8%). C’est seulement à la condition que les quatre principaux acheteurs asiatiques arrêtent d’acheter du pétrole iranien que les revenus du pétrole iranien en subiront vraiment le contrecoup. Si ces pays asiatiques ne réduisent pas ou ne cessent pas leurs achats de pétrole en Iran, et que les pays européens le font (ces pays indiquent désormais qu’ils soutiennent une baisse de leurs comptes d’importations pour 5 à 12% des exportations de pétrole iranien), l’Iran sera contraint de vendre plus de pétrole à l’Asie. Disposant d’une plus grande influence, les acheteurs asiatiques demanderont probablement une baisse des tarifs. Cela réduira les revenus du pétrole pour l’Iran, mais pas suffisamment pour forcer Téhéran à mettre un terme à son programme nucléaire.
L’Administration aurait déjà demandé à ces pays asiatiques de réduire leurs achats de pétrole iranien. Le ministre saoudien du pétrole a dit, et les chiffres de la production de pétrole de son pays le confirment, qu’ils fourniront ce dont leurs consommateurs et le marché auront besoin. Un ancien haut fonctionnaire de l’Administration Obama a déclaré que les Saoudiens ont offert de palier une partie de l'approvisionnement iranien. (Le pétrole d’Arabie Saoudite est comparable à celui de l’Iran et pourrait le remplacer dans une large mesure – en contraste avec le pétrole libyen de très haute qualité, perdu au cours de la récente guerre civile, qui était irremplaçable, ce qui a conduit à une montée en flèche des prix du pétrole). Les requêtes américaines ont largement été ignorées, bien qu'on pourrait considérer que la Corée du Sud a réduit, voire arrêté ses importations de pétrole iranien.
“La loi sur les sanctions de la BCI a fourni à l’Administration Obama une plus grande influence dans ses discussions avec les autres pays, mais probablement pas suffisamment. Les autres pays savent que l’Administration Obama répugne à instaurer complètement ces sanctions, pas seulement parce qu’elle est préoccupée par les prix du pétrole, mais aussi parce que rompre les relations avec des banques étrangères qui détiennent des obligations américaines pourrait perturber le système financier américain.
Pour convaincre les acheteurs asiatiques de réduire ou de cesser leurs achats de brut iranien, l’Administration aura besoin de s’armer de plus que de la seule loi BCI et du pétrole saoudien. Des responsables de haut-rang autour d’Obama devront répéter à l’envi et de façon claire que la seule alternative aux sanctions reste une frappe militaire américaine ou israélienne contre les installations nucléaires iraniennes. En d’autres termes, le choix offert devrait être : réduire/cesser l’achat de pétrole iranien pour faire suffisamment pression sur l’Iran pour qu’on puisse résoudre pacifiquement le problème qu’il pose par la menace nucléaire, ou affronter le véritable risque de voir l’approvisionnement en pétrole de l’Iran et du Golfe persique s’interrompre pour quelques temps, à la suite d’une action militaire.
Au lieu de cela, l’Administration est publiquement sortie de cette voie pour exprimer son opposition à une frappe militaire israélienne et conditionne le public américain –et, par la même occasion, l’Iran, la Chine et les autres – à ne pas s’attendre à une frappe américaine. En dépit des allégations répétées qu’il n’écarte « aucune option de la table », le Secrétaire à la Défense Léon Panetta a suivi la pratique de son prédécesseur, Robert Gates, en soulignant les risques d’une intervention militaire. A deux reprises, récemment, Panetta a insisté sur « les conséquences inattendues » d’une frappe. Il a fait la liste de cinq catégories d’entre elles, lors d’un discours, le 2 décembre, dont l’augmentation des prix du pétrole, que le Washington Post a vertement critiqué dans un éditorial intitulé : « Les mauvais signaux envoyés à Téhéran ». Panetta et Obama ont, depuis, musclé leur rhétorique, mais les dégâts étaient faits. Effectivement, l’administration n’a lancé aucun préparatif crédible, au moins de façon ouverte, telles que de grandes manœuvres militaires et des déploiements en vue d’une frappe. [Ndt : si cette remarque pouvait être criticable au début de ce mois de janvier, du fait de l'annonce d'Austere Challenge 12, depuis Obama et Panetta se sont ravisés, au prétexte des déclarations de Moshe Ya'alon à la radio, qui exposait, ni plus ni moins, que les incertitudes que l'Administration Obama faisait peser, telles qu'elles sont exposées dans cet article de Makovsky et Goldstein. Il s'agit donc bien des tendances lourdes de la politique suivie]
Ainsi, aussi longtemps que l’Administration continue de déroger publiquement à l’option militaire contre l’Iran, les sanctions BCI resteront probablement insuffisantes. En évitant publiquement l’option militaire, menée par Israël ou/et les Etats-Unis, l’Administration a réduit les chances que les sanctions BCI puissent marcher et a rendu, par inadvertance, la guerre plus, et non moins, probable.
C’est certainement le cas, en ce qui concerne une attaque israélienne. Les responsables israéliens ont suggéré que les sanctions BCI sont la dernière chance d’empêcher pacifiquement l’Iran de parvenir au nucléaire. Une attaque israélienne pourrait, effectivement, conduire les prix pétroliers à grimper, dont la durée et l’étendue dépendrait de la nature et de l’intensité de la réponse iranienne. L’Iran pourrait répliquer contre Israël par des tirs de missiles et il a à sa disposition son supplétif terroriste libanais du Hezbollah, capable de faire pleuvoir ses 50 000 roquettes sur le centre et le nord d’Israël, y compris sur Tel Aviv. Et encore, l’Iran pourrait être contraint de ne pas trop étendre ses zones-cibles, de crainte qu’elles ne s’attirent une réplique américaine. Un conflit israélo-iranien pourrait durer quelques jours ou quelques semaines, au cours desquels les cargos pétroliers seraient empêchés de transporter leur pétrole à partir de l’Iran ou/et du Sud de l’Irak. Les prix du pétrole devraient certainement atteindre des sommets au cours d’un tel conflit, et cette augmentation pourrait se poursuivre après-coup, si les installations pétrolières iraniennes ont subi de lourds dégâts.
Si les Etats-Unis attaquent l’infrastructure nucléaire de l’Iran, l’assaut serait probablement plus soutenu et plus intensif qu’une frappe israélienne, et le théâtre du conflit couvrirait une zone plus vaste, conduisant à de plus fortes hausses, sur une plus longue durée, pour les tarifs pétroliers. Une attaque américaine pourrait aussi infliger plus de dégâts à l’Iran. Les Etats-Unis pourraient employer leurs immenses moyens aériens et maritimes pour tirer des missiles et larguer des bombes, qui ne feraient pas que paralyser l’infrastructure nucléaire de l’Iran, mais aussi ses capacités militaires offensives et défensives. L’Iran pourrait réagir avec férocité, sachant qu’il a moins à perdre que s’il répliquait seulement à une frappe israélienne. Il pourrait tenter d’interrompre le flux de pétrole passant par le Détroit d’Hormuz –en utilisant des mines, des bateaux-suicide, des missiles et ainsi de suite – pour empêcher ses voisins ennemis d’exporter du pétrole et ainsi d’augmenter le coût d’une action militaire pour accroître la pression internationale sur les Etats-Unis, afin qu’ils cessent leur action. Les Iraniens pourraient aussi attaquer les installations pétrolières de l’Arabie Saoudite et d’autres voisins qui soutiendraient une frappe américaine. La durée et l’étendue d’un tel impact pourrait dépendre de l’ampleur, si tel est le cas, des dégâts contre les installations énergétiques des pays du Golfe Persique, en particulier, en Arabie Saoudite. Les Etats-Unis et d’autres pays consommateurs importants pourraient pondérer l’augmentation des prix du pétrole en puisant dans leurs réserves stratégiques, mais la hausse des prix du pétrole resterait significative.
Cependant, aussi grand soit l’impact d’une action militaire sur les prix du pétrole, pour contenir la menace iranienne, il pourrait être minime et de courte durée, comparé à une période prolongée d’augmentation plus importante de ces prix du pétrole, qui pourrait résulter du fait que l'Iran franchisse le seuil d'acquisition de l'arme nucléaire. Cela pourrait, en effet, générer des dommages économiques sur le long terme pour les Etats-Unis.
Prenons en considération, d’abord, les conséquences potentielles qu’aurait l'affirmation d'un Iran nucléaire. Cela pourrait provoquer une prolifération en cascade à travers tout le Moyen-Orient, avec l’Arabie Saoudite ouvrant la voie vers l’acquisition de capacités nucléaires. L’Iran pourrait aussi être en bonne posture pour transférer des matériaux nucléaires à ses alliés terroristes. Plus encore, l’Iran pourrait chercher à dominer les Emirats du Golfe Persique riches en énergie et l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP), en menaçant ainsi l’existence même d’Israël, en déstabilisant les régimes arabes modérés, en menant la subversion contre les efforts américains en Irak et en Afghanistan, ce qui enhardirait les radicaux, violemment opposés au processus du paix, augmentant le soutien au terrorisme et aux guerres par procuration à travers toute la région. L’ancien sous-Secrétaire à la Défense, Eric Edelman, Andrew F. Krepinevich Jr et Evan Braden Montgomery ont exposé dans Foreign Affairs, qu’Israël et l’Iran pourraient, chacun avoir de bonnes raisons de frapper l’autre en premier à coup d’armes nucléaires.
De façon similaire, l’Ambassadeur Dennis Ross, qui occupait récemment les fonctions de conseiller spécial au Moyen-Orient pour Obama à la Maison Blanche, expliquait qu’en une telle situation, « le potentiel d'une mauvaise évaluation » [des risques liés à la situation] serait énorme. Il est plus que probable qu’une sorte quelconque de conflit pourrait surgir dans la région, impliquant les deux puisances nucléaires et qu'il ne pourrait, finalement, qu’entraîner les Etats-Unis. La position américaine dans la région, y compris la perception de sa capacité à sécurise le Détroit d’Hormuz, chuterait considérablement.
Toutes ces conséquences potentielles ne feraient qu’augmenter les risques liés à la sécurité et à l’approvisionnement en pétrole, en provenance du Golfe Persique, devenus bien pires, du fait de la force croissante de l’Iran dans l’OPEP et des besoins des pays importateurs d’énergie, essentiellement, en Asie, de trouver des arrangements délicats avec l’Iran. Le résultat serait une augmentation de long terme du pétrole, de l’essence, et des prix du carburant qui flamberaient. Ceci aurait alors d’autant plus d’implications négatives sérieuses et durables sur l’économie fragile des Etats-Unis. Les prix du pétrole reflètent de nombreux facteurs, comprenant les coûts du transport, l’approvisionnement courant, les volumes fournis tels qu'on peut les projeter sur l’avenir, en fonction de la demande. A leur tour, les coûts du transport comprennent les primes d’assurance, qui varient avec les risques que les navires puissent être endommagés ou coulés. Le risque politique lié à la garantie de livraison est un autre facteur : même sans armes nucléaires, l’Iran a, déjà, fait croître les prix du pétrole en menaçant simplement de fermer le Détroit d’Hormuz. Pour faire court, les projections en termes d'approvisionnement et de transit reflètent la prise en compte des risques, et de tels risques pourraient être énormément plus élevés, si l’Iran développe des armes nucléaires. Pour commencer à évaluer les conséquences économiques, on doit considérer que toute augmentation d’environ 10% des prix annuels du pétrole provoque une baisse de presque 0, 5% du Produit Intérieur Brut des Etats-Unis.
Il est impossible de prédire les dénouements de la crise iranienne. Le scénario le plus souhaitable, mais le moins probable, serait une résolution élégante qui n’inflige aucun sacrifice économique de court terme aux Etats-Unis. Si cette crise ne se résout que grâce à des sanctions lourdes ou une action militaire, les conséquences économiques néfastes pourraient être significatives, mais relativement de courte durée. La pire perspective, aussi bien sur le plan stratégique qu’économique reste l’avènement d’un Iran doté de l’arme nucléaire. Les Etats-Unis ont un besoin urgent d’empêcher cela d’advenir, autant pour des raisons sécuritaires qu’économiques.
Michael Makovsky, ancien analyste pétrolier pour des sociétés d’investissement, est Directeur du Projet de Sécurité Nationale au sein du Centre Politique Bipartisan et auteur de « La Terre Promise de Churchill ».
Laurence Goldstein est fondatrice de la Fondation pour la Recherche en Politique Energétique et ancienne consultante pour le Bureau du Secrétaire de la Défense.
16 JAN 2012, VOL. 17, NO. 17 •
Par MICHAEL MAKOVSKY et LAWRENCE GOLDSTEIN
http://www.weeklystandard.com/articles/real-oil-shock_616149.html?page=1
Adaptation : Marc Brzustowski.